En Afrique du Sud, des chercheurs s’appuient sur des pêcheurs pour surveiller une aire marine protégée. En découlent des données fiables pour les uns, des revenus complémentaires pour les autres, et une confiance mutuelle. Le soleil s’élève lentement au-dessus des monts Kogelberg. Nicolas Taylor et quatre autres pêcheurs descendent habilement de la remorque le Clementine, un canot de cinq mètres, et le mettent à l’eau. Ils s’avancent sur les eaux calmes de l’Atlantique en laissant derrière eux la ville de Kleinmond, sur la côte sud-ouest de l’Afrique du Sud. Une heure plus tard, ils arrivent à l’aire marine protégée (AMP) de Betty’s Bay et se mettent au travail. Mais au lieu de poser des filets à langoustes comme ils l’auraient fait naguère, ils installent des stations vidéo sous-marines télécommandées avec appâts. Ces pêcheurs constituent un élément essentiel d’un projet de recherche destiné à quantifier le volume des populations de poissons et de langoustes du Cap au sein de l’AMP. Si on commence normalement par réunir ces informations de base avant de créer une zone protégée, nombre des réserves sud-africaines ont été instaurées sans objectifs clairs de gestion des ressources ni informations environnementales. L’AMP de Betty’s Bay, par exemple, a vu le jour en 1973 sous le nom de « réserve maritime H. F. Verwoerd », du nom d’un Premier ministre du temps de l’apartheid, qui avait une maison de vacances à proximité. Ce « lien malheureux avec un homme politique » constituait un obstacle supplémentaire, « et l’AMP était mal vue », explique Pierre de Villiers, le directeur des activités maritimes et côtières de CapeNature, l’organisme provincial chargé de la gestion de la réserve. Les pêcheurs ne tenaient pas compte de ses limites et pêchaient comme ils l’avaient toujours fait, ce qui a déclenché un conflit avec les autorités qui perdure à l’heure actuelle. Faute de données – et de ressources pour en obtenir –, il était difficile de justifier l’interdiction de la pêche en bateau et de la collecte de fruits de mer. Pour combler ces lacunes, les scientifiques de CapeNature et trois ONG – le World Wide Fund for Nature South Africa (WWF-SA), Moving Sushi et la South African Shark Conservancy (SASC) – ont recruté douze pêcheurs pour déployer, moyennant finances, des stations vidéo sous-marines avec appâts dans et à côté de l’AMP. Deux jeunes du coin – eux aussi rémunérés – ont été chargés de regarder les vidéos et d’identifier les espèces filmées puis d’aider les chercheurs à quantifier les populations sur les différents sites, souligne courrierinternational.com.
Le Togo envisage développer la pisciculture dans toutes les régions du pays
C’est l’ambitieux projet porté par la Fédération des Unions Coopératives de Pêches du Togo (FENUCOOPETO) qui compte sur les pouvoirs publics pour développer la pisciculture dans toutes les régions du pays. Parti du constat que le Togo dispose de nombreuses ressources halieutiques mais importe en moyenne par an 70 à 80.000 tonnes de poissons contre une production nationale de 25.000 tonnes, les pêcheurs estiment qu’ils peuvent contribuer à renverser la tendance d’importation. Le besoin national annuel évalué à 100.000 tonnes pourrait être atteint si les projets structurants sont développés et soutenus par le gouvernement. Cela créerait des emplois, enrichir l’économie locale et permettrait aux populations de consommer des poissons sains. « C’est un projet déjà soumis au Mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques (MIFA S.A). Nous avons demandé à notre nouveau ministre, Edem Kokou Tengué de faire diligence pour nous aider à suivre ce dossier auprès du mécanisme afin qu’un jour ce projet puisse enfin voir le jour », confie Abdou-Derman Adam-Mouhamadou, secrétaire général de la fédération. Dans toutes les régions du pays, des lieux ont été déjà identifiés par la fédération en concertation avec les experts pour mener à bien les activités de pisciculture », a-t-il poursuivi. Lors d’une récente visite au nouveau port de pêche de Lomé, le ministre en charge du secteur, Edem Kokou Tengue avait rassuré les acteurs de la pêche d’une bonne collaboration, insisté sur la professionnalisation du secteur pour qu’il contribue efficacement à la formation de la richesse nationale, renseigne pour sa part agridigitale.net.
Les pêcheurs de Ruyigi crient à l’extorsion des fonds
Les pêcheurs qui prestent dans le lac Rweru et les commerçants de poissons de la place s’insurgent contre les amendes illégales qui leur sont exigées par le chef de zone Masaka et le chef d’antenne de police de cette zone. Ces pécheurs et commerçants demandent que cette persécution cesse. Les pêcheurs du lac Rweru et les commerçants de poissons de la colline Cagakori indiquent que cela fait deux semaines que le chef de zone Masaka du nom de Célestin Ngendakuma et Gabriel Muzehe le chef d’antenne de police dans cette zone les accusent d’exporter clandestinement le poisson au Rwanda. Une accusation rejetée par ces pêcheurs et commerçants qui parlent plutôt de stratégie visant à les extorquer. « Ils arrêtent les pêcheurs du Lac Rweru pour leur soutirer de l’argent. Les accusations portées contre eux n’ont aucune preuve. Pourtant, ils se voient contraints de payer une somme exorbitante pour recouvrer leur liberté ». Une fois incarcérés, révèle notre source, on leur exige de donner des pots de vin déguisés en amendes. « Cette persécution a commencé il y a quelques jours. L’officier de police est aussi complice. Il y en a qui avaient été libérés moyennant paiement d’une somme de cent mille francs burundais. Un seul d’entre eux a pu sortir du cachot après avoir débourser cet argent. C’est vraiment dommage qu’on soit persécuté par ceux-là même qui devraient nous protéger ». Les pêcheurs et les commerçants de poissons de la place demandent aux supérieurs hiérarchiques de ces deux autorités de les ramener à l’ordre et de leur exiger de couper court avec ce comportement, note rpa.bi.
Moctar FICOU / VivAfrik

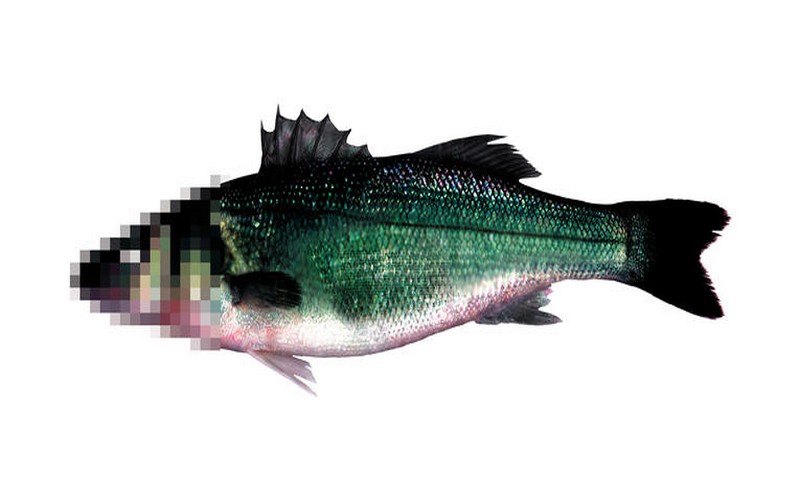
Laisser un commentaire